Sélection des ouvrages
SÉLECTION DES 6 OUVRAGES POUR LE PRIX 2025
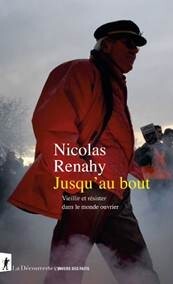
Nicolas RENAHY, Jusqu'au bout. Vieillir et résister dans le monde ouvrier, Paris, éd. La Découverte, Collection « l’envers des faits », 2024, 208 p.
Bruno, Christian, Clairette, Christiane et Viviane sont des "anciens de Peugeot" à Sochaux-Montbéliard. Cabossés par le travail en usine, ces retraités placent le militantisme syndical et la solidarité amicale au cœur de leur vie. À travers quelles expériences apprennent-ils à vieillir ensemble ? À partir d'une plongée sensible dans leur quotidien, ce livre donne à voir une réalité méconnue : celle du vieillissement physique et social dans le monde ouvrier. Il jette une lumière nouvelle sur des enjeux oubliés de la réforme des retraites et sur la distance au politique dans les classes populaires, montrant l'importance des résistances locales au capitalisme et à l'extrême droite. Retrouvant, trente ans après, certains enquêtés de La Misère du monde, Nicolas Renahy propose une sociologie incarnée des vieillesses et des appartenances sociales, qui invite à repenser la condition ouvrière à l'aune des rapports de classe, de genre et de génération. Ni passifs ni "inactifs", ces anciens ouvriers et ouvrières sont loin d'être mis en retrait par leur retraite. Alors que la fin du monde ouvrier ne cesse d'être annoncée, ces "vieilles branches" continuent de lutter, d'être solidaires et de transmettre aux plus jeunes le sens du combat contre les injustices. Jusqu'au bout.
Nicolas Renahy est directeur de recherche au département sciences sociales de l’INRA, directeur du CESAER (Centre d’Économie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux, Dijon), chercheur associé à l’équipe Enquêtes, Terrains, Théories du Centre Maurice Halbwachs (Paris Jourdan). Après un second cycle d’anthropologie sociale (Paris 5) et un DEA de sciences sociales (EHESS-ENS), il a réalisé une thèse (EHESS, 1999) puis une HDR (Nantes, 2011) en sociologie.
Thomas FOVET, Camille LANCELEVÉE
La prison pour asile ? Enquête sur la santé mentale en milieu carcéral, Paris, 2024, Ed. Maison des sciences de l’homme, Collection « Interventions », 188 p.
Les données épidémiologiques le montrent depuis le début des années 2000 : la population carcérale française est composée pour une part importante de personnes avec des troubles psychiatriques graves. Face à ce constat et forts de leur expérience respective de sociologue et de psychiatre en milieu carcéral, Camille Lancelevée et Thomas Fovet mènent l’enquête : pourquoi les prisons françaises semblent-elles être devenues des asiles contemporains ? Peut-on désormais les considérer comme des lieux de soin ? Dans quelle mesure la peine de prison est-elle devenue un temps thérapeutique ? Cet ouvrage interroge les évolutions croisées de la psychiatrie publique et de la justice pénale pour comprendre la réalité complexe des troubles mentaux en prison et l’expérience de celles et ceux qui s’y trouvent confrontés.
Camille Lancelevée et Thomas Fovet viennent de sortir un petit ouvrage, dense et synthétique de 187 pages, illustré de cas cliniques et d’un journal de terrain, qui en titre pose la question de fond : « La prison pour asile ? ». Camille Lancelevée est maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Strasbourg et Thomas Fovet, maître de conférences en psychiatrie de l’adulte à l’université de Lille. Leurs écrits s’appuient sur leurs travaux de recherche et un « dialogue au long cours » qu’ils ont pu établir entre eux deux sur la prison et la psychiatrie. Camille Lancelevée a mené des recherches sur ce sujet de 2011 à 2022. Elle a ouvert un premier terrain ethnographique sur le quotidien des établissements pénitentiaires de Lille en approchant les personnels pénitentiaires puis l’équipe psychiatrique, et son travail a fait l’objet d’une thèse comparant les pratiques professionnelles de santé mentale en milieu carcéral en France et en Allemagne, thèse soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales en 2016. Thomas Fovet, psychiatre en milieu pénitentiaire depuis 2014, a mené plusieurs études épidémiologiques en milieu pénitentiaire et récemment sur la santé mentale des sortants de prison.
Les deux auteurs font d’emblée le constat que prison et hôpital psychiatrique jouent un nouvel épisode de leurs relations avec un « transfert de ressources qui amène les groupes les plus visés par les politiques pénales, à savoir les segments les plus pauvres de la population, à trouver en prison les services de soins plus difficilement accessibles dans le reste de la société »…
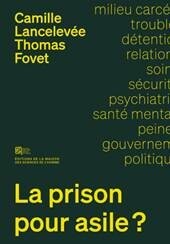
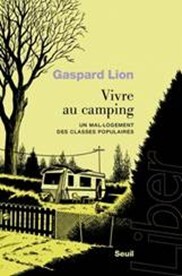
Gaspard LION, Vivre au camping : un mal-logement des classes populaires, Paris, Ed. du Seuil, Collection « Liber », 2024, 320 p.
La flambée des prix du logement qui s’est amorcée à partir des années 2000 a conduit à des difficultés sociales de plus en plus massives sur l’ensemble du territoire français. Ni le logement social ni le principe d’un droit au logement opposable n’ont apporté de solutions satisfaisantes et le nombre des mal-logé·es et des sans-logis n’a cessé de croître. Le sociologue Gaspard Lion identifie un phénomène nouveau, reflet de cette crise sociale majeure : le « camping résidentiel » qui a gagné la France en écho aux trailer parks états-uniens. À partir d’une enquête ethnographique menée en immersion dans cinq campings de la région parisienne durant quatre ans, ce livre saisit, dans leur diversité et leur intimité, les vies quotidiennes de celles et ceux qui ont fait du camping leur domicile. Ainsi, ce livre dévoile la condition sociale d’une portion croissante des classes populaires qui vit inaperçue aux marges des grandes villes, et expose une forme, jusqu’ici inexplorée, de logement et de précarité, révélatrice de changements structurels à l’œuvre dans la société française.
Gaspard Lion est sociologue et maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord. Ses travaux portent sur les classes populaires et les formes de logement dégradées et non ordinaires. Cet ouvrage est issu de sa thèse intitulée « Habiter en camping. Trajectoires de membres des classes populaires dans le logement non ordinaire », soutenue en 2018 et pour laquelle il a reçu le prix de thèse de l'EHESS.
Eline de GASPARI, Handicap et genre au quotidien : Une sociologie des personnes ayant une trisomie 21 par le prisme des rapports sociaux, Paris, ed. L’Harmattan, Collection « Questions sociologiques », 2024, 296 p.
Cette recherche sociologique explore les dynamiques complexes du handicap et du genre dans la vie quotidienne des personnes ayant une trisomie 21. Dans un monde qui met en avant l’autonomie individuelle et la performance, cette étude novatrice discute et remet en question les normes capacitistes établies. Elle met en lumière les enjeux sociaux liés au rapport au corps, à la santé, à la communication, au travail, à l’affectivité, à la sexualité ou encore au care. Grâce à une méthodologie qualitative et ethnographique, l’auteure rend compte du quotidien de ces personnes et donne une voix centrale à leur expérience. Leur parole permet d’intégrer leur perspective dans la construction des connaissances scientifiques. Ainsi, cette recherche révèle les rapports de domination propres au capacitisme et au sexisme et plus particulièrement la manière dont les modèles d’autonomie individuelle influencent la vie quotidienne des personnes ayant une déficience intellectuelle. Les stratégies déployées par les personnes concernées pour augmenter leur participation sociale sont mises en lumière. Ce livre offre une perspective unique et essentielle sur les réalités des personnes ayant une trisomie 21, remettant en question les conceptions traditionnelles du handicap.
Eline De Gaspari est docteure en Sociologie et professeure associée à la Haute École et École Supérieure de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis où elle enseigne et étudie les thématiques des rapports sociaux, du handicap ou encore de l’inclusion.

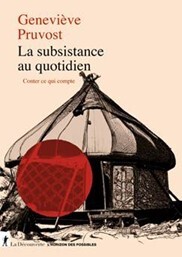
Geneviève PRUVOST, La subsistance au quotidien - Conter ce qui compte, Paris, Ed. La Découverte, Collection « Horizon des possibles », 2024, 504 p.
Dans les sociétés de consommation-production où nous vivons, le travail de subsistance est devenu invisible et, avec lui, tous les circuits mondialisés dont nous dépendons. D'autres formes de vie s'épanouissent pourtant, qui mettent au centre les flux de matières, l'entraide, les circuits courts, et construisent pas à pas une autonomie écologique. Rien d'utopique dans ces manières d'exister mais un engagement entier et réfléchi, dont il importe aujourd'hui, face à l'évidente catastrophe environnementale, de cerner au plus près les conditions de possibilité.
Il a fallu pour cela inventer une forme inédite d'observation, en devenant graphomane du labeur quotidien. Sur fond de dix ans d'enquête auprès d'alternatives rurales, ce livre propose de zoomer sur une maisonnée, dans un bocage peuplé d'habitats légers : des boulangers-paysans y travaillent pour réenclencher des cycles d'abondance, les mains dans la terre, en synergie avec un biotope et tout un réseau de sédentaires et de nomades. Qui fait quoi, sur combien de mètres carrés, avec quelles techniques, quels moyens financiers, quelle formation, combien de personnes, d'animaux, de plantes, d'outils ? Tous les échanges en argent, en nature, en paroles ont été consignés, stylo et montre en main, pour conter ce qui compte.
Voici le récit haletant de cette lutte feutrée qui politise le moindre geste. Car tel est bien l'enjeu : donner chair et réalité à un monde dont la radicalité est méconnue ; montrer que des alternatives à la "modernité capitaliste" résistent et qu'elles peuvent gagner du terrain.
Geneviève Pruvost, médaille de bronze du CNRS, est sociologue du travail et du genre au Centre d'étude des mouvements sociaux (EHESS), et diplômée de permaculture. Ses recherches portent sur la politisation du moindre geste et les alternatives écologiques. Elle a notamment publié, avec Coline Cardi, Penser la violence des femmes.
Samuel BOURON, Politiser la haine, la bataille culturelle de l’extrême-droite identitaire, Paris, Ed. La Dispute, 2025, 160 p.
Impossible de déjouer l’ascension électorale du Rassemblement national sans comprendre le soutien que lui apportent un ensemble d’organisations non partisanes, extraparlementaires, d’intellectuels ou encore d’influenceurs, bref sans regarder du côté de cette nébuleuse identitaire qui lui sert de marchepied. Restés en marge de l’arène électorale, les identitaires se sont progressivement placés au cœur d’un écosystème médiatique en se fondant dans les cadres du néolibéralisme pour gagner en respectabilité. Par la politisation des affects, ils construisent une altérité radicale entre un « nous » (les Français « de souche », les hommes, le vrai peuple) et un « eux » (les musulmans, les féministes, les trans, les « woke »), qui contribue à rendre populaires les idées réactionnaires. Ce livre est le fruit d’une enquête au long cours. Débutée par une immersion chez les identitaires en 2010, elle est enrichie par l’analyse sociologique de leur médiatisation, de leurs filiations idéologiques et de leurs réseaux.
Samuel Bouron est sociologue, maître de conférences à l’université Paris-Dauphine-PSL et chercheur à l’IRISSO.
« S’engager dans l’observation participante revenait donc – à la manière de Loïc Wacquant dans Corps et âme – à cerner ce qui fait « vibrer » les militants. Tout au long de mon terrain, j’ai donc joué le rôle du militant – mais sans me séparer de mon identité de chercheur. Quand on incarne un tel rôle, on va suffisamment loin pour comprendre, d’une part, comment les militants pensent et pour être capable de penser comme elles et eux et, d’autre part, comment ces manières de penser et de s’engager s’incarnent jusque dans les corps – dans la façon dont on sculpte son corps, dans les tatouages, l’esthétique, etc. À mon sens, l’observation participante ne consiste pas seulement à enregistrer ce qu’on voit : elle consiste à se servir de soi, de ce que l’on est et de son expérience subjective comme d’un instrument d’objectivation. J’ai notamment développé une grille d’observation où je notais ce qui me déplaisait ou ce que j’aimais bien chez certains militants, de façon à objectiver mes affinités, mon système de goût et de dégoût. J’ai aussi réfléchi à la position que j’occupais au sein du mouvement et aux relations que j’entretenais aux uns et aux autres. Par exemple, une manière un peu provocatrice de formuler la question, c’est de demander : « quel facho je suis ? », parce que cette question oblige à interroger la position que j’ai endossée à l’intérieur de ce groupe militant et la manière dont elle a créé un système de goût et de dégoût ; et surtout parce que formuler les choses ainsi oblige à cesser de regarder la population des identitaires à partir d’une position de surplomb, extérieure, pour au contraire s’y inclure et produire de la réflexivité. Typiquement, lorsque j’étais au camp d’été, je me rappelle très bien que le moment que je préférais dans la journée, c’était les séances de boxe – qui étaient pourtant les moments les plus violents. Cela m’a permis de prendre conscience que, parmi les identitaires, alors que j’étais idéologiquement le plus éloigné de l’extrême-droite, j’appartenais à la fraction qui était la plus violente – pour la boxe, il y avait trois groupes de niveaux dans le camp d’été, allant des débutants aux confirmés, groupe auquel j’appartenais. Mais les plus aptes à la violence physique ne sont pas nécessairement les plus violents sur le plan idéologique. Cela m’a donc amené à déconstruire le lien qu’on fait systématiquement entre violence physique et idéologie d’extrême-droite. »
Enquête chez les identitaires : travail sur soi, travail du corps, travail à couvert. Entretien avec Samuel Bouron.







